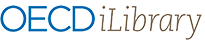Résumé
Le soutien massif apporté promptement par les pouvoirs publics à l’économie et le taux de vaccination élevé ont permis au PIB de retrouver rapidement son niveau d’avant la pandémie (Graphique 1). Néanmoins, des contraintes affectant l’offre, des pénuries de main-d’œuvre et une forte inflation pèsent sur la reprise.
Les effets de la guerre en Ukraine et la forte incertitude s’ajoutent aux difficultés actuelles liées à la montée des tensions inflationnistes et des pressions qui s’exercent sur l’offre, ainsi qu’à la reprise déséquilibrée consécutive à la pandémie. Malgré une croissance du PIB de 6.2 % en 2021 et en dépit de la résilience globale des marchés du travail face à la pandémie, la reprise a été inégale, les travailleurs jeunes et peu qualifiés ayant été touchés de manière disproportionnée par la crise du COVID-19. L’inflation a atteint des niveaux records et le taux de vacance d’emploi a sensiblement augmenté pour s’établir à 4.7 %, en raison de problèmes d’inadéquation des compétences et de la faiblesse du taux d’activité.
Les perspectives à court terme sont particulièrement incertaines. La croissance devrait ralentir (Tableau 1), la diminution de la demande extérieure et l’embargo de l’UE sur le pétrole russe s’ajoutant à la forte inflation, malgré le niveau élevé de l’épargne, l’indexation automatique des salaires et les mesures d’aide face à la hausse des prix de l’energie qui atténuent en partie ces difficultés. À court terme, les autorités budgétaires peuvent apporter un soutien temporaire, judicieusement ciblé et sous conditions de ressources pour amortir les effets immédiats des chocs subis par les prix des produits de base et alimentaires sur les ménages et les entreprises vulnérables.
Assurer la reconversion professionnelle et renforcer l’employabilité des groupes vulnérables peut contribuer à remédier aux pénuries de main-d’œuvre. Il faudrait cibler les politiques actives du marché du travail sur les catégories caractérisées par un taux d’emploi particulièrement bas (les chômeurs de longue durée, les personnes faiblement qualifiées, les mères de jeunes enfants, les immigrés et les personnes handicapées). Il faudrait recourir davantage aux outils statistiques pour permettre des interventions plus précoces, et les services fournis, notamment en matière de formation, devraient être adaptés aux besoins individuels des travailleurs défavorisés.
Une réforme des mécanismes de fixation des salaires au niveau de l’entreprise, conjuguée à la préservation d’un niveau élevé de coordination des salaires qui contribue au faible niveau des inégalités salariales, peut contribuer à favoriser le redéploiement des ressources en main-d’œuvre. Il faudrait décentraliser davantage les négociations salariales, dans le cadre des accords de branche, afin que l’évolution des salaires puisse mieux correspondre à celle de la productivité au niveau de chaque entreprise. Cela aiderait les entreprises les plus performantes à attirer des travailleurs qualifiés et à se développer, et les entreprises peu productives à surmonter un épisode de fléchissement temporaire de la demande et à réduire le risque de devenir des « entreprises zombies », ce qui renforcerait la croissance de la productivité.
Les plans de relance offrent l’occasion de soutenir la reprise et d’accélérer la transformation numérique et la transition écologique. Les goulets d’étranglement au niveau de l’offre et l’augmentation du coût des matériaux, ainsi que la réglementation stricte relative aux permis de bâtir et aux procédures environnementales peuvent faire obstacle à la réalisation d’investissements majeurs, en particulier s’agissant de la cinquième génération de communications mobiles (5G) et de la rénovation des bâtiments. Toutes les régions se sont engagées à simplifier ces procédures, mais il faudrait que les efforts déployés en la matière soient concentrés en début de période.
La dette publique s’est hissée à 108.4 % du PIB en 2021, et des efforts considérables seront nécessaires pour stabiliser puis réduire le ratio dette/PIB.
Une stratégie d’assainissement budgétaire à moyen terme, fondée sur des examens des dépenses, devrait être mise en œuvre pour commencer à réduire les dépenses publiques et le ratio dette/PIB. Les dépenses publiques, qui représentaient environ 55 % du PIB en 2021, sont élevées et il est possible d’améliorer l’efficience des dépenses dans certains domaines (comme l’éducation). Le cadre budgétaire présente des lacunes, notamment l’absence de budgétisation pluriannuelle et de règles de dépenses, qui peuvent amoindrir la transparence, la cohérence et l’efficacité de la politique budgétaire au fil du temps. Il pourrait également être utile de renforcer le mandat du Conseil supérieur des finances (CSF) en le chargeant de réaliser de manière transparente, uniforme et très visible un travail approfondi d’analyse et de suivi des finances publiques aux différents niveaux de gouvernement, même s’il ne peut élaborer des recommandations ou des objectifs contraignants.
Une vaste réforme fiscale est prévue à la suite d'évaluations d'impact détaillées permettant d'en analyser les conséquences sur différents indicateurs socio-économiques importants. Le coin fiscal sur les travailleurs à bas salaire reste supérieur à la moyenne de l’OCDE, ce qui réduit le taux d’activité et le pouvoir d’achat des ménages modestes. Il est possible d’élargir la base d’imposition en réduisant les dépenses fiscales régressives. Dans le cadre de la réforme prévue, il faudrait envisager d'introduire un barème d’imposition progressif pour toutes les formes de revenus du capital.
Les dépenses de retraite devraient se hisser de 12.2 % à 15.2 % du PIB d’ici à 2070, et l’âge effectif du départ à la retraite reste bas (Graphique 2). Une réforme des pensions axée sur le renforcement du taux d’emploi des seniors est prévue dans le plan national pour la reprise et la résilience, ce qui est bienvenu. Il serait possible de favoriser une augmentation de l’âge effectif de sortie du marché du travail en mettant en place des décotes (minorations de pension) et des surcotes (majorations de pension) qui s’appliqueraient, respectivement, en cas de départ avant et après l’âge légal de la retraite. Une amélioration des compétences est nécessaire pour préserver l’employabilité des seniors, mais leur taux de participation à la formation tout au long de la vie est faible. L’accès insuffisant à l’information et l’orientation concernant les formations, ainsi que le soutien plus limité des employeurs, constituent des obstacles à la participation des seniors.
Les inégalités de revenu sont faibles, mais des réformes sont nécessaires pour renforcer l’égalité des chances. Les risques de pauvreté sont élevés pour les chômeurs, les inactifs et les personnes faiblement qualifiées. Les taux d’emploi particulièrement bas des mères de jeunes enfants, des immigrés et des personnes handicapées tiennent à la faiblesse de leurs compétences, numériques en particulier, et à des incitations au travail insuffisantes. L’inégalité scolaire est forte (Graphique 3) : les élèves défavorisés ont accumulé un retard d’apprentissage de plus de 3 ans à l’âge de 15 ans. En outre, le coût du logement constitue une surcharge financière pour 70% des ménages à faible revenu.
Des réformes sont nécessaires à tous les niveaux de gouvernment, compte tenu de la répartition des compétences. Un certain nombre de mesures des plans de relance correspondent à des priorités d’action et besoins différents, et peuvent contribuer à faire en sorte que les transitions numérique et écologique n’aggravent pas la fracture sociale.
Il est nécessaire de renforcer les incitations au travail pour les parents isolés et de prendre des mesures pour faciliter le retour au travail des bénéficiaires de prestations d’invalidité et d'indemnités de maladie. Pour l’heure, les parents isolés à faible revenu, en particulier les femmes, sont dissuadés de travailler par l’augmentation des impôts et la diminution des prestations qu’ils subissent en cas de prise d’un emploi. Des prestations liées à l’exercice d’un travail soutiendraient l’emploi et éviteraient des phénomènes de dépendance prolongée aux prestations sociales. Les lacunes du soutien individuel à destination des bénéficiaires de prestations d'invalidité et d'indemnités de maladie freinent leur retour au travail.
Les différences de participation à la formation tout au long de la vie suivant l’âge et le niveau de compétences sont considérables. Il faut fournir une orientation professionnelle efficace aux personnes qui en ont le plus besoin et ont du mal à appréhender la multiplicité et la complexité des dispositifs de formation tout au long de la vie proposés par différents organismes. Sachant que les services d’orientation professionnelle sont de plus en plus fournis en ligne, il faudrait conserver pour les personnes ayant de faibles compétences numériques ou un accès limité à internet la possibilité de bénéficier de ces services en face à face.
Il faudrait réduire les écarts de résultats scolaires dans l’enseignement obligatoire. Les établissements d’enseignement sont incités à diversifier leurs effectifs d’élèves, mais pas à améliorer les résultats scolaires de ceux qui sont en en difficulté. Il faudrait utiliser des indicateurs de performance fiables ainsi que d'autres données sur la réussite scolaire pour éclairer les décisions de financement des établissements en fonction des progrès accomplis dans l'accompagnement des élèves défavorisés. La mobilité limitée entre les filières générale et professionnelle réduit les perspectives des élèves issus de milieux défavorisés.
Une amélioration des incitations et de la formation des nouveaux enseignants peut réduire leur taux de sortie du métier, et les attirer dans des établissements où la concentration d’élèves défavorisés est forte. Il faudrait renforcer les programmes d’initiation destinés aux enseignants débutants pour que la transition entre formation et exercice de la profession soit fluide. Inciter les enseignants à exercer leurs fonctions dans des établissements défavorisés en leur offrant des gratifications financières ou de meilleures perspectives de carrière et de stablilité peut également apporter une pierre à l’édifice.
Le manque de logements abordables et de qualité peut accentuer la ségrégation résidentielle et l‘inégalité des chances. L’offre de logements sociaux est très nettement inférieure à la demande, en particulier dans les grandes villes comme Bruxelles. Dans l’immédiat, il faudrait élargir à davantage de ménages à faible revenu l’accès aux aides locatives, en complément des projets d’accroissement du parc de logements sociaux.
Il est crucial de renforcer la coordination et la cohérence entre les gouvernements fédéral et régionaux et de rehausser les prix du carbone pour orienter les investisseurs privés.
La réalisation des objectifs climatiques et énergétiques passe par une meilleure coordination entre les différents niveaux de gouvernement. La mise à jour du Plan national énergie-climat (PNEC) devrait se traduire par une trajectoire plus cohérente de réalisation des objectifs nationaux et offrir une vision nationale intégrée des plans adoptés aux niveaux fédéral et régional. Il a fallu sept ans pour parvenir à l’accord interne de partage des efforts correspondant aux objectifs climatiques fixés à l’horizon 2020, et il faudrait mettre à profit les enseignements tirés de ce processus pour éviter que celui relatif aux objectifs climatiques définis pour 2030 traîne en longueur.
Il n’existe pas de prix explicite du carbone pour les émissions non couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union européenne (SEQE -UE), comme celles des secteurs du bâtiment et des transports, et le prix global des émissions de carbone est faible (Graphique 4). Une fois que le choc énergétique en cours s'atténuera, une tarification uniforme du carbone à moyen terme permettrait de réduire efficacement les émissions de GES, mais elle doit aller de pair avec des mesures d’accompagnement propres à soutenir les ménages défavorisés, à garantir la clarté et la prévisibilité de l’environnement réglementaire et à promouvoir l’innovation verte.