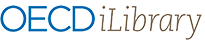Browse by: "A"
Index
Index par titre
Index par année
Cette étude analyse le système des dépenses publiques de la Hongrie et développe des recommendations de politique pour son amélioration. Malgré les progrès réalisés dans la gestion des finances publiques dans les années 1990, le niveau des dépenses publiques et des impots par rapport au revenu national reste relativement élevé, alors que le processus budgétaire est détérminé par des considérations de court terme et se concentre sur des financements d'inputs plutot que de résultats. Le programme économique de pré-accession soumis à la Commission Européenne pour la période 2001-2004 devrait etre complété par une réforme profonde des dépenses publiques pour atteindre ses objectifs ambitieux - qui nécessitent d'importantes économies budgétaires. Cette réforme devrait se baser sur un cadre de dépenses à moyen terme orienté sur les résultats, utilisant des procédures transparentes et exhaustives couvrant l'ensemble des activités des administrations publiques. Des dépenses efficaces dans ...