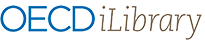Browse by: "P"
Index
Index par titre
Index par année
Le secteur du capital-risque aux Etats-Unis est le plus ancien et le mieux développé des pays de l’OCDE. Plusieurs sociétés de haute technologie, qui ont fait leurs preuves dans l’informatique et les communications, mais aussi dans les secteurs et services liés à la santé, ont été financées par du capital-risque. Les jeunes entreprises à forte croissance bénéficient également d’apports réguliers de financements complémentaires de la part des investisseurs providentiels (business angels), des investisseurs institutionnels, et des seconds marchés. Les pouvoirs publics ont joué un rôle déterminant pendant les premières phases du développement du secteur du capital-risque aux Etats-Unis par le biais du program Small Business Investment Company (SBIC) et de divers dispositifs de promotion de la technologie. La réduction des taux d’imposition des plus-values et l’assouplissement des règles applicables aux fonds de pension permettant à ces derniers de faire des investissement à risque à ...
Malgré le niveau élevé d’investissement privé par prises de participation qui prévaut au Royaume-Uni, l’apport de capitaux aux petites entreprises de technologie est relativement peu abondant. Les investisseurs institutionnels tant nationaux qu’étrangers continuent d’intervenir en priorité dans les dossiers d’entreprises plus matures. Le Royaume-Uni a mis en œuvre différentes initiatives visant à améliorer l’accès des petites entreprises au financement par prises de participation, dont des dispositifs généreux d’incitation fiscale et le soutien de réseaux d’investisseurs providentiels (business angels). Il reste toutefois difficile d’axer les financements sur les PME, les jeunes entreprises et les régions excentrées. Une nouvelle stratégie inspirée de l’exemple américain a récemment été mise en œuvre. Elle conjugue apport de capitaux publics et gestion privée pour attirer des financements privés au profit de petits projets, et assouplit le régime applicable aux investisseurs ...
La Suède fait partie des pays de l’OCDE où la part des investissements en capital-risque dans le PIB est la plus élevée. Étant donné la structure industrielle du pays, et la place prépondérante qu’y occupent les grands groupes industriels, il s’agit toutefois pour l’essentiel d’investissements d’origine étrangère destinés à des entreprises déjà bien établies. Au plan national, l’absence de demande du côté des entrepreneurs et le manque de compétences en gestion pour les investissements en fonds propres entravent le développement de l’industrie du capital-risque. Le gouvernement suédois envisage actuellement de modifier divers aspects du cadre fiscal et réglementaire de l’investissement afin de mieux répondre aux besoins des entreprises technologiques de petite taille. La suppression des restrictions quantitatives appliquées aux opérations des investisseurs institutionnels, la diminution des taux d’imposition et la restructuration des programmes de prises de participation seraient à ...
Le marché coréen du capital-risque, d’importance négligeable au début des années 1990, s’est très fortement développé ces dernières années : il a presque triplé entre 1998 et 2001. En pourcentage du PIB, la Corée se situe désormais parmi les pays de l’OCDE les plus avancés pour ce qui concerne l’investissement en capital-risque. La Corée a subi la forte crise financière de 1997-98 et a réussi à relever le défi consistant à réduire l’influence des grandes entreprises (les chaebol) et à accroître le rôle des petites entreprises de technologie. En 1998, le gouvernement a pris l’initiative de développer le marché du capitalrisque en procédant à des injections directes de capitaux, en octroyant des aides fiscales et des garanties du capital généreuses, et en accordant à certaines petites entreprises le statut d’« entreprises à risque élevé ». Les sujets de préoccupation sont essentiellement la nécessité de privatiser davantage le système de capitalrisque et celle d’accroître le nombre ...
La part du capital-risque dans le PIB d’Israël est la plus élevée de toute la zone OCDE. Pour l’essentiel, le capital-risque israélien est dirigé vers des entreprises aux premiers stades de leur existence, en particulier vers les jeunes entreprises opérant dans les technologies de l’information et des communications (TIC) et les biotechnologies. Le secteur israélien du capital-risque s’est constitué grâce à l’effet de levier qu’ont exercé les fonds publics, notamment via le groupe YOZMA, sur les apports émanant d’entreprises et d’institutions étrangères. Il est aujourd’hui nécessaire de changer de tactique pour maintenir les apports de capital-risque privé tant pour les entreprises existantes que pour celles en phase de démarrage. Tandis que les investisseurs étrangers bénéficient de nouvelles incitations, on pourrait utiliser des allègements fiscaux, un accroissement des opportunités offertes aux investisseurs institutionnels et une réforme de la Bourse israélienne pour stimuler ...
Au Danemark, le niveau des investissements en capital-risque, exprimé en pourcentage du PIB, est l’un des plus faibles des pays de l’OCDE. Dans les années 1990, le gouvernement a fait plusieurs tentatives pour agir du côté de l’offre, mais les mesures prises n’ont pas toujours obtenu le succès escompté. Les problèmes sont de plusieurs ordres : absence de culture de l’investissement à risque, niveaux élevés d’imposition et complexité du système fiscal, rôle prépondérant des banques et faible contribution des autres investisseurs institutionnels sur le marché. Une nouvelle stratégie a été adoptée qui table maintenant sur un fonds d’investissement public réorganisé et sur des incubateurs d’entreprises technologiques pour fournir des capitaux d’amorçage aux jeunes entreprises. Il faudra poursuivre dans cette voie pour diversifier encore davantage les financements proposés aux entreprises en phase de création et développer la culture de l’entreprenariat. La présente étude examine les ...
Exprimés en pourcentage du PIB, les niveaux d’investissement en capital-risque du Canada sont parmi les plus élevés des pays Membres de l’OCDE. Entre 1995 et 2001, la croissance de l’offre de capital-risque y a été phénoménale et plus de 200 fonds nouveaux de capital-risque se sont créés. Toutefois, l’essentiel du capital-risque canadien est consacré à la poursuite du financement de petites et moyennes entreprises (PME) – et non de nouveaux dossiers impliquant de jeunes entreprises – et aux secteurs manufacturiers traditionnels. À la fin des années 1990, les pouvoirs publics canadiens se sont lancés dans des tentatives de diversification des sources de capital-risque en libéralisant la réglementation applicable aux investisseurs institutionnels et étrangers, en modifiant les avantages fiscaux et en créant des fonds publics de participation au capital. Les investisseurs étrangers – américains notamment – sont maintenant les principaux acteurs du secteur ; leurs financements ciblent ...
Ce document exploite les données d’entreprises de la base de données ORBIS pour évaluer la planification fiscale internationale des entreprises multinationales. Les transferts de bénéfices vers les pays à taux d'imposition inférieur sont mesurés en comparant la rentabilité des entités multinationales ayant des liens différents avec des pays ayant des taux d'imposition différents et donc différentes possibilités de transferts de bénéfices. Le document examine également d'autres aspects de la planification fiscale qui ont été moins documentés dans la littérature empirique, comme l'exploitation des disparités entre les systèmes fiscaux et les régimes fiscaux préférentiels, en comparant la façon dont les bénéfices déclarés par les entités multinationales sont imposés par rapport à des entités non-multinationales avec des caractéristiques similaires. L'analyse se fonde sur des données financières non consolidées, qui, malgré leurs limites, sont considérées comme le meilleur échantillon international de données d’entreprises existant. Les résultats sont basés sur un très grand échantillon d'entreprises (1,2 millions d'observations de comptes de multinationales) dans 46 pays de l'OCDE et du G20 et une procédure sophistiquée pour identifier les groupes multinationaux. Ils fournissent des preuves solides que les multinationales transfèrent leurs bénéfices vers les pays à taux d’imposition inférieur et que les grandes multinationales exploitent également les disparités entre les systèmes fiscaux et les traitements fiscaux préférentiels pour réduire leur fardeau fiscal. Au total, la perte de recettes fiscales nette estimée varie de 4% à 10% des recettes mondiales d’impôt sur les sociétés. L'analyse empirique montre également que des règles strictes « anti-évitement » contre la planification fiscale sont associés à des transferts de bénéfices réduits, mais aussi à des coûts de conformité plus élevés pour les entreprises.
Il a été démontré qu’une solution au déséquilibre de la balance des opérations courantes dans les pays ayant un excédant serait d’entreprendre des réformes structurelles. Cela devrait augmenter leur potentiel de croissance, ce qui est supposé soulager la pression sur la situation de la balance des opérations courantes. Cet article examine de près comment de telles réformes structurelles dans les marchés financiers, du travail et de la production sont susceptibles d’influer les comptes courants. Il vérifie aussi empiriquement, au moyen d’un ensemble de séries temporelles techniques (lesquelles contrôlent l’influence des situations conjoncturelles relatives, l’équilibre budgétaire et le taux de changes réèl) si des réformes dans ces secteurs ont une relation significative avec les comptes courants. Il en ressort que ces indicateurs de réformes structurelles ont une relation significative avec les comptes courants, mais que la contribution de ces variables à l'explication de la ...
Contrairement à la tendance observée durant les années 60 et 70, certains des principaux pays de l’union européenne et le Japon ne referment plus l’écart qui les sépare des États-Unis en termes de revenu par habitant. Cet écart est peut-être même en train de se creuser davantage depuis le milieu des années 90. Alors qu’au Japon l’écart de PIB par habitant vis-à-vis des États-Unis est dû essentiellement au retard de la productivité, dans le cas de l’union européenne il s’explique largement par une plus faible utilisation des ressources de main d’œuvre, reflétant à la fois des taux d’emploi moins élevé et un nombre inférieur d’heures ouvrées. Cette étude donne une vue d’ensemble des liens entre les politiques structurelles et la performance des marchés du travail et des produits. Ce faisant, elle fournit un certain nombre d’indicateurs de performance et de politique qui peuvent êtres utilisés pour évaluer le progrès réalisé sur le plan des réformes structurelles ...